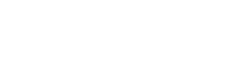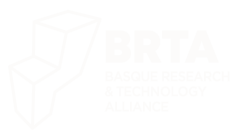La mer comme décharge
Comme les mers du monde entier, les eaux d'Euskal Herria sont pleines de déchets. Le plastique est la plus grande partie. Initialement macro. Puis micro. Et les habitants de la mer finissent par manger ce plastique, ces déchets. Oihane Têtes Basurko d'AZTI et Manu Soto López de PiE-UPV/EHU enquêtent sur la distribution, la composition et l'impact des déchets marins, en précisant que le problème est grave.
« À tous les endroits d’Urdaibai, nous avons trouvé des microplastiques », explique Manu Soto López, sous-directeur de la Station Maritime de Plentzia (PiE-UPV/EHU). « Le problème est énorme. Le plastique est très enraciné dans notre vie. Et le problème est l'utilisation massive et incontrôlée que nous faisons. Nous ne pensons rien aux déchets. » Et trop souvent, ces déchets finissent en mer. « Même si nous le jetons sur la montagne, il arrivera à la mer avant ou après. »
En fait, la plupart des déchets marins proviennent des rivières. Ou du moins c'est ce que disent les calculs généraux. Cependant, ce n’est pas toujours le cas, explique la chercheuse d’AZTI, Oihane Head Basurko: « Il y a une affirmation générale que 70-75% des déchets marins proviennent des rivières. Mais il y a d'autres études qui disent qu'il faut regarder le local. Et nous avons vu que la moitié des déchets que nous trouvons à la surface du golfe de Biscaye provient d'activités maritimes: pêche, aquaculture, navires marchands, etc. Cela est dû, d’une part, à la grande activité dans nos eaux et, d’autre part, à l’influence des courants et de la dynamique du golfe, qui reste ici ce qui s’introduit ».
Et en nuançant les affirmations générales, Head a également voulu clarifier une autre idée fréquemment mentionnée: « On dit souvent que la plupart des déchets arrivent à la mer à travers les rivières du sud de l’Asie, où la population est grande et où la gestion des déchets est très mauvaise. Oui, mais ici, nous n'avons pas de déchets. Là se trouve la poubelle, ou peut être dans le Pacifique ou dans d'autres mers. Nous ne pouvons pas regarder ailleurs. »
Ce qui conduit les rivières
En Europe, 307-925 millions de déchets flottants sont déversés chaque année dans les rivières. Et les chercheurs de l'AZTI ont analysé ce qui se passe dans les rivières d'Euskal Herria. Une étude publiée il y a deux ans a analysé la dynamique des déchets de huit rivières: Deba, Urola, Oria, Urumea, Oiartzun, Bidasoa, Urdazuri et Aturri. Pour créer un modèle de route des ordures ont été utilisés drifters, bouées flottantes avec GPS.
« Nous avons vu qu’il y a des déchets de faible flottabilité, comme les sacs en plastique, qui sont transportés par l’effet du courant, et d’autres de haute flottabilité, comme les bouteilles, qui sont transportés plus rapidement par l’effet du vent », explique M. Head.
Selon le modèle élaboré, 97% des particules à haute flottabilité en été sont piégées sur le littoral après une semaine. En automne, ce taux est réduit à 54%. Dans le cas des déchets à faible flottabilité, cependant, moins de 25% sont pris au piège. La majeure partie s'étend sur la mer ouverte.
Connaître cette dynamique est utile pour la collecte et la gestion des déchets côtiers. « Il est très important de savoir combien il y a, où il va et où il s’accumule », dit Head. « Nous travaillons beaucoup avec les administrations et ce type d’information aide à améliorer la gestion, à faire des nettoyages et à travailler sur la prévention. »
Par exemple, on travaille avec la députation forale de Gipuzkoa parce qu'ils ont découvert un problème dans le flysch, qui accumule beaucoup de caoutchouc. « C’est très rare. Vous avez généralement des bouteilles, des plastiques, etc. Mais dans ce cas, nous avons un type de déchets très spécial. Eh bien, en analysant la dynamique, nous pouvons voir où elle vient, de quelle rivière elle procède. Et cela permet de commencer à étudier ce qui se passe dans cette rivière, quelle industrie il y a… ».
En plus d'analyser ce que les rivières transportent, on a analysé ce qu'il y a en mer. Par exemple, ils ont participé à une étude qui a analysé les déchets des mers du monde entier. Cette étude a révélé que 80% des déchets marins sont en plastique. Sur les 112 catégories de déchets utilisées, les trois quarts des déchets trouvés étaient de 10 catégories, toutes en plastique. Parmi eux, les sacs à usage unique, les bouteilles, les verres de nourriture et les emballages étaient les quatre produits les plus abondants, la moitié des pièces trouvées.
Pendant quatre ans, des échantillons de plastiques de surface ont été prélevés pour connaître ce qui se trouve dans les eaux du Pays basque avec des phoques plastiques. Et dans un autre ouvrage, publié en 2022, il est confirmé, comme le disaient les modèles, que la zone sud-est du golfe de Biscaye est une zone d'accumulation. « Nous n’avions pas de données pour Euskal Herria et nous voulions voir combien nous pouvions et où nous pouvions. » « On parle toujours que la Méditerranée est très polluée par les plastiques, car nous avons vu que dans cette région, dans les microplastiques, nous sommes à des niveaux méditerranéens. »

Dans les échantillons analysés, 93 % étaient des microplastiques (moins de 5 mm), 7 % des mésoplastiques (5 mm-2,5 cm) et 1 % des macroplastiques (plus de 2,5 cm), tandis que les microplastiques en poids étaient 28 %, le mésoplastique 26 % et les macroplastiques 46 %.
Stockage des déchets
D'autre part, ils ont noté que dans la région de Hendaia à Baiona, on accumule cinq fois plus de plastique qu'entre Hondarribia et Mutriku. Et il y a des zones de collecte où il y a 10.000 fois plus de déchets que l'extérieur. « Ce sont des rivières en surface qui peuvent avoir trois ou quatre mètres de largeur et un kilomètre de longueur », explique Head. « Nous étudions maintenant les processus physiques que ces rivières produisent ; s’ils sont courants, s’ils sont des points de rencontre de masses d’eau différentes… Et nous ne savons pas si cela se produit seulement à la surface ou si cela se produit à la verticale. »
En fait, ils ont jusqu'à présent analysé la surface de l'eau, mais ils verront bientôt ce qui est en dessous. «Des études menées ailleurs indiquent que la superficie n'est que de 15 % et que la plupart d'entre elles sont en profondeur. Mais nous n’avons pas de données d’ici, et nous ferons bientôt une campagne pour analyser la colonne et le fond de l’eau ».
Savoir où les déchets sont accumulés est utile, entre autres, pour pouvoir les récupérer. « Il est très difficile de recevoir des microplastiques, mais la macro peut être récupérée », explique Head. « Les microplastiques sont si petits qu’ils collent à quelque chose, donc avec la macro, de nombreux microplastiques sont également collectés. Mais surtout, il s’agit que la plupart du microplastique se produit à partir de la macro. »
L'analyse des échantillons a montré que la plupart des microplastiques étaient des fragments. Peu d'exemplaires ou de pellets ont été trouvés. Il y avait aussi des fibres, mais la plupart étaient des fragments, c'est-à-dire des macroplastiques. « Il est donc important de supprimer la macro. On parle toujours de microplastiques par leur effet, mais si on enlève la macro, on enlève aussi le micro. »
Microplastiques dans la vie
En fait, les chercheurs de PiE étudient l'influence des microplastiques sur la vie marine. « Nous étudions depuis près de deux ans ce qui se passe avec les microplastiques à Urdaibai et ailleurs », explique Soto. « Nous prenons des moules, des crabes, des cils, des huîtres… et nous avons tous trouvé des plastiques. Ce que nous trouvons le plus, ce sont les fibres PET. » Ces fibres proviennent principalement des vêtements confectionnés en fibres synthétiques. « L’industrie textile est l’une des activités les plus polluantes », explique Soto.
Soto a expliqué que l'impact des microplastiques sur les êtres vivants est double: physique et chimique. « Les poissons, etc. les mangent comme matière organique en suspension. Ils peuvent s'accumuler progressivement dans l'estomac ou dans le tractus gastro-intestinal. À la fin, il peut être obstrué ou rempli et ne pas pouvoir manger. Une conséquence pourrait être de mourir de faim. »
De son côté, l'impact chimique peut provenir de différents aspects. D'une part, les plastiques contiennent des additifs tels que des protecteurs d'ondes ultraviolettes, des retardateurs de flamme, etc. ). « Ces additifs peuvent être libérés par des enzymes du tube digestif et être toxiques. » Mais les microplastiques sont aussi des vecteurs. « Ils agissent comme des chevaux de troie à ceux qui sont retenus pour les métaux lourds, les hydrocarbures et même les agents pathogènes », explique Soto. « Les chimistes de notre groupe analysent ces dynamiques : comment le cadmium s’accroche à mesure que le plastique vieillit, les HAP, les PCB… »
En général, les laboratoires de PiE étudient comment leur toxicité augmente à mesure que les plastiques vieillissent. « C’est très important pour nous. Parce que nous étudions les conséquences biologiques et notre objectif est de connaître l'état de santé de ces animaux. Il peut arriver, par exemple, que, malgré sa survie, il ne puisse pas être blâmé. Dans ce cas, la population serait stérilisée et risquerait de disparaître. »
En outre, lors de l'analyse des microplastiques contenant les animaux, ils ont réalisé que tout ce qui est souvent considéré comme du plastique n'est pas plastique. « Jusqu’à présent, dans la plupart des cas, la classification des microplastiques a été visuelle », explique Soto. « Nous avons utilisé la spectroscopie Raman. Cette technique montre en toute sécurité s'il s'agit de plastique ou non. Et nous avons vu que dans les études réalisées visuellement nous avions une estimation de 80%. De nombreuses particules semblent visuellement plastiques, mais elles peuvent être des matières inorganiques, du verre, etc. »
« Cependant, le problème est là », a voulu clarifier Soto. « Nous avons trouvé des microplastiques dans tous les animaux. La plupart des filtrants : moules et huîtres ». Les poissons n'ont pas encore été analysés. Cependant, Soto a mis en évidence une différence du point de vue humain: « Pour les poissons, nous mangeons le muscle, où en principe il n’y a pas de microplastiques. Dans le cas des moules, nous les mangeons entiers et il peut y avoir un problème. »
Dans leurs expériences en laboratoire avec des moules, ils ont vu que lorsque les microplastiques sont plus petits qu'un micron, ils quittent rapidement l'organisme. Ces microplastiques, au moyen des selles, vont au substrat, y sont déposés et sont disponibles pour les animaux indigènes. « Nous l’avons prouvé en laboratoire et nous étudions maintenant ce qui se passe dans l’environnement », explique Soto. Pour ce faire, ils enquêtent sur des animaux vivant dans les sédiments, tels que les moustiques. « Nous n’avons pas encore toutes les données, mais dans tous les points d’Urdaibai, nous avons trouvé des microplastiques. Le problème est là. Il y a de plus en plus de plastiques sur nos côtes, non seulement dans l'eau, mais aussi dans les sédiments. Et cela peut être dangereux aussi bien pour l’écosystème que pour l’économie et la santé des personnes », explique Soto.
Solutions
« Le problème est le gras », dit Head. « Je suis optimiste car il y a beaucoup d’initiatives pour rendre visible, sensibiliser et résoudre le problème. Mais il y a beaucoup de travail à faire. »
Il existe deux types de solutions, selon Head. D'une part, ceux ci-dessus: les lois. Un exemple en est celui des plastiques à usage unique interdits. « Dans les ordures du littoral, des pailles, etc. Et ils furent interdits. Maintenant, il s'est produit avec des couvercles de tetrabriks et des bouteilles. Il est très intéressant de noter que les données de recherche influencent les lois. Mais des changements plus profonds sont nécessaires ».
En ce qui concerne les solutions ci-dessous, pour Têtes, vous pouvez faire beaucoup de choses. « Il est important de savoir où se trouvent les problèmes pour trouver des solutions efficaces. » Par exemple, sachant qu’une grande partie des déchets de notre côte provient de la pêche, ceux d’AZTI travaillent avec les pêcheurs. « Nous avons maintenant le projet SEARCULAR pour construire des filets et des engins de pêche circulaires, en utilisant des matériaux plus durs (pour éviter la production de microplastiques) et plus facilement recyclables. »
La sensibilisation de la société est également essentielle. À cet égard, il mentionne le projet Ulysses: « Pour étudier comment les accumulations de déchets se produisent, nous tirerons des milliers de drifters. Pour ce faire, nous distribuerons des kits dans les centres pour réaliser ces drifters. Ensuite, lorsque nous les lançons à la mer, ils pourront suivre les lieux où circule chaque drifter. Et cela permet de travailler en classe ces sujets ».
Soto considère également que la sensibilisation est essentielle. « Les législations devraient aider, c’est clair. Mais pour changer les législations, la société doit faire pression. Et nous devons changer beaucoup de comportements. Le plastique ne peut être interdit. Notre bien-être est lié à la production de plastique. Mais nous pouvons faire beaucoup de choses. Par exemple, nous ne pouvons plus utiliser de plastiques à usage unique sans en penser les conséquences. En définitive, le plus grand problème est là. Il y a aussi des accidents et des déversements, mais le principal problème est l’utilisation massive. »
« Il nous coûte trop de prendre conscience de la dimension du problème », dit Soto. Mais il est également optimiste: « Je me souviens toujours que nous avions un problème de couche d’ozone. Nous avons réussi à réduire les CFC et la couche d’ozone se régénère. »